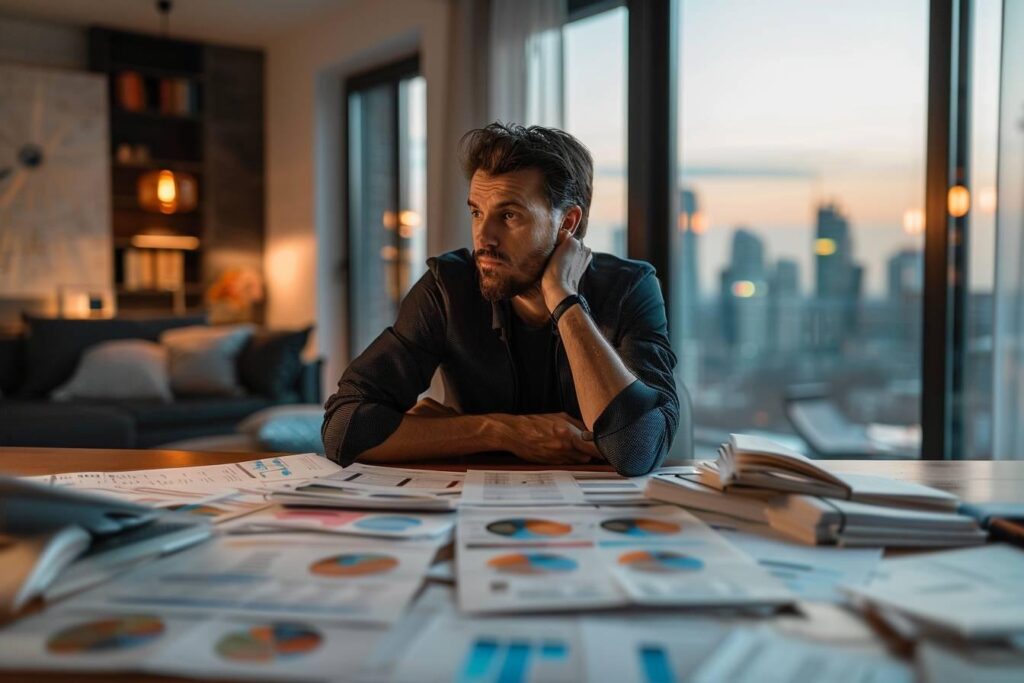L’essor des plateformes de trading en ligne, notamment dans des domaines hautement spéculatifs comme le Forex (marché des changes) et les options binaires, a été parallèlement marqué par une recrudescence des fraudes massives. Les litiges qui en résultent mettent en jeu non seulement la responsabilité des courtiers frauduleux, mais aussi celle des acteurs qui facilitent la circulation des fonds : les Prestataires de Services de Paiement (PSP).
Deux décisions majeures de la Cour de cassation, rendues en 2022 et 2025, éclairent l’étendue de l’obligation de vigilance des PSP face aux escroqueries financières en ligne, marquant une distinction cruciale entre l’invocation de la réglementation sur la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et celle de l’obligation générale de vigilance du droit commun.
Cet article se concentre sur l’arrêt Cass. com., 1er octobre 2025, n° 22-23.136, qui confirme la responsabilité partagée d’un PSP dans le cadre d’une escroquerie au trading, et le met en perspective avec l’arrêt Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, qui délimite strictement l’utilisation des règles LCB-FT par les victimes.
I. L’Affirmation de la responsabilité délictuelle des PSP : analyse de l’arrêt Cass. Com., 1er oct. 2025 (Affaire Worldpay/Seroph)
L’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2025 (n° 22-23.136) rejette le pourvoi formé par la société Worldpay AP Ltd et confirme les conclusions de la Cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022, établissant la responsabilité conjointe de deux prestataires de services de paiement, Worldpay AP Ltd (PSP anglais) et Seroph Holding BV (fournisseur de solutions de paiement néerlandais), pour la disparition des fonds d’un investisseur français, M. [X], sur des plateformes de trading frauduleuses.
A. Contexte et rôles des intermédiaires
L’affaire trouve son origine dans le préjudice subi par Monsieur [R] [X], un retraité de nationalité française, qui a été démarché courant 2014 par plusieurs entités — notamment Finch Markets, BanQ of Broker, 50 Option et Triompheoption — l’incitant à investir des fonds sur leurs plateformes de trading en ligne, spécialisées dans le Forex et les options binaires. Au total, M. [X] a investi la somme de 80 500 euros. Les fonds ont disparu suite à la nature frauduleuse des plateformes et la disparition de ses interlocuteurs.
Les sociétés Worldpay AP Ltd et Seroph Holding BV n’étaient pas les plateformes de trading elles-mêmes, mais les prestataires de services de paiement (PSP) qui ont permis la circulation des fonds vers ces sites frauduleux :
- Rôle de Worldpay AP Ltd (PSP Anglais) : Worldpay est un prestataire de services de paiement agréé par la FCA (Royaume-Uni). Son rôle était de fournir des services de paiement et de réception de fonds à l’international. M. [X] a effectué les virements depuis son compte bancaire personnel (BNP Paribas en France) vers un compte bancaire appartenant à Worldpay, ouvert dans les livres de la banque [G] (Natwest) en France.
- Rôle de Seroph Holding BV (Fournisseur de Solutions de Paiement Néerlandais) : Seroph, qualifiée de « fournisseur de solutions de paiement », était un client de Worldpay. Les deux sociétés étaient liées par un « contrat de traitement des paiements » (Payment Processing Agreement). Seroph utilisait le réseau et la technologie de Worldpay, et plus important encore, le compte bancaire français de Worldpay était mis à la disposition de Seroph pour ses prestations de paiement. Seroph fournissait ainsi une solution pour que les plateformes de trading frauduleuses (comme 50 Option) puissent encaisser les fonds des investisseurs.
- Le Circuit des Fonds Litigieux : Le montage permettait aux plateformes frauduleuses, souvent offshore ou non régulées, de rassurer les victimes françaises en leur demandant d’effectuer des virements vers un compte bancaire détenu en France (le compte Worldpay/Natwest). Les ordres de virement ordonnés par M. [X] mentionnaient le nom du bénéficiaire final (par exemple, 50 Option) ainsi qu’une référence spécifique à Seroph, prouvant la connaissance de la chaîne de transaction par les PSP. Ce mécanisme a permis la disparition des fonds.
Le litige portait donc sur la responsabilité de Worldpay et Seroph, en tant que professionnels, pour avoir manqué à leur obligation générale de vigilance en permettant sciemment ou par négligence le transit de fonds vers des sites notoirement frauduleux, dont certains figuraient sur la liste noire de l’AMF avant même les virements de M. [X].
B. Application du droit français : la localisation du dommage (Règlement Rome II)
Un point important de la décision est la détermination du droit applicable, cruciale en l’espèce puisque Worldpay soutenait que seul le droit anglais devait s’appliquer.
La Cour de cassation, comme l’avait fait la Cour d’appel, a jugé que le litige était soumis au droit français. Cette conclusion est justifiée par le Règlement « Rome II » (CE n° 864/2007) relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles.
La Cour rappelle que l’interprétation de ce règlement doit être cohérente avec le Règlement « Bruxelles I » (CE n° 44/2001) concernant la compétence juridictionnelle. Ainsi, lorsque le préjudice allégué est de nature purement financière, la loi applicable est celle du pays du domicile de la victime si le dommage se réalise directement sur son compte bancaire ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.
Dans le cas de M. [X] :
- Il était un retraité français, domicilié en France.
- Il a ordonné les virements depuis son compte BNP en France.
- Ces fonds ont été transférés sur un compte français de la société Worldpay, ouvert auprès de la banque Natwest (anciennement Royal Bank of Scotland) en France, et mis à disposition de la société Seroph.
- La disparition des fonds à partir de ce compte Worldpay/Seroph, situé en France, a été considérée comme la cristallisation du lieu de survenance du dommage.
La Cour de cassation a ainsi légalement justifié l’application du droit français à l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre les PSP.
C. Le manquement à l’obligation générale de vigilance (Article 1240 du Code Civil)
L’arrêt de 2025 établit que les sociétés Worldpay et Seroph ont manqué à leur obligation générale de vigilance fondée sur l’ancien article 1382 du Code civil (devenu 1240).
1. La mise à l’écart de la réglementation LCB-FT Comme le juge la Cour d’appel et le confirme implicitement la Cour de cassation, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration imposées par la réglementation LCB-FT (L. 561-5 et s. du Code monétaire et financier) pour réclamer des dommages-intérêts. Ces règles servent l’intérêt général (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) et non les intérêts privés.
2. Les anomalies apparentes et le défaut d’agrément En revanche, le manquement à l’obligation générale de vigilance est caractérisé par plusieurs éléments :
- Défaut de vérification de l’agrément de Seroph : L’ambiguïté planant sur l’activité de Seroph, qui se présentait comme un « fournisseur de solutions de paiement » mais exerçait en réalité des prestations de services de paiement soumises à agrément en Europe, aurait dû inciter Worldpay à vérifier que son co-contractant disposait de l’agrément requis. Le défaut de vérification de cet agrément par Worldpay constitue une faute, car cette vérification fait partie de l’obligation générale de vigilance.
- Connaissance des risques : Worldpay et Seroph étaient des professionnels. Il est établi que Seroph avait communiqué à Worldpay l’identité des sites marchands pour lesquels elle agissait, dont BanQ of Broker et 50 Option. Or, ces sociétés figuraient sur la liste noire des placements à haut risque ou arnaques connues par l’Autorité des marchés financiers (AMF) dès 2013. La mention du nom du bénéficiaire final (50 Option) et de la référence Seroph (ACXXXX) sur les ordres de virement suffisait à alerter ces professionnels des risques encourus.
La Cour de cassation estime que la Cour d’appel a caractérisé l’existence d’anomalies apparentes résultant du fait que Worldpay ne pouvait ignorer que Seroph relevait des professions réglementées et que son compte présentait des virements au bénéfice de sociétés inscrites sur la liste noire de l’AMF.
3. Le lien de causalité Le manquement des PSP a été jugé en lien de causalité avec le préjudice de M. [X]. Les placements frauduleux ont été rendus possibles grâce à l’utilisation de la technologie et du compte Worldpay ouvert en France, mis à la disposition de Seroph.
D. La faute contributive de l’investisseur (partage de responsabilité)
Malgré la faute des PSP, la Cour a retenu l’imprudence de la victime.
- M. [X] a fait preuve d’imprudence en investissant sur des plateformes non fiables. Une simple recherche sur Internet, avant son premier investissement en 2014, lui aurait permis de constater que deux des plateformes étaient déjà inscrites sur la liste noire de l’AMF et que les mises en garde des internautes étaient « particulièrement claires et alarmantes ».
- L’imprudence de M. [X] a concouru à la réalisation de son dommage à hauteur de 50 % (faute à équivalence).
- En conséquence, Worldpay et Seroph ont été condamnées in solidum à payer à M. [X] la moitié de son investissement initial (36 000 euros sur 72 000 euros investis).
En outre, la demande d’indemnisation pour perte de chance a été rejetée. Le fait d’investir sur des sites notoirement frauduleux est considéré comme dénué de toute probabilité de gain et donc de tout aléa.
II. Mise en perspective avec l’arrêt Cass. com., 21 sept. 2022 (Affaire Banque/Client)
L’arrêt du 1er octobre 2025 renforce la responsabilité des PSP qui, par leur négligence professionnelle (obligation générale de vigilance), facilitent les fraudes. Cependant, cette responsabilité est clairement distinguée de l’application des obligations spécifiques de LCB-FT, position réaffirmée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 septembre 2022 (n° 21-12.335).
A. Le principe de spécialité de la LCB-FT (Arrêt 2022)
Dans l’affaire jugée en 2022, des héritiers poursuivaient une Caisse de crédit mutuel pour la perte de 2,8 millions d’euros investis par leur aïeul dans des sociétés financières européennes via des virements bancaires.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a fermement établi que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier pour réclamer des dommages-intérêts.
Ces obligations ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (intérêt général). De plus, les déclarations de soupçon (Tracfin) sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre ces crimes.
B. La vigilance de droit commun dans les deux Arrêts
1. L’affaire de 2022 (Banque/Client direct) Dans l’affaire de 2022, le banquier (Caisse de crédit mutuel) a été mis hors de cause car il n’a pas été prouvé de manquement à son obligation contractuelle de vigilance. La banque avait constaté que :
- Les virements ne présentaient pas d’anomalie matérielle.
- Les montants, bien qu’importants (2,8 millions d’euros), étaient proportionnels à l’importance du patrimoine du client, et le compte restait créditeur.
- Le client avait persisté dans ses opérations, signant même une décharge de responsabilité après avoir été informé des anomalies découvertes par la banque (recherches que cette dernière n’était pas tenue de faire).
2. L’affaire de 2025 (PSP/Intermédiaire) Contrairement à la banque en 2022 qui agissait en relation directe avec son client, la responsabilité de Worldpay en 2025 est engagée non pas vis-à-vis du client final (M. [X]), mais en raison de sa faute professionnelle dans la relation avec son propre client (Seroph), un fournisseur de solutions de paiement.
Le manquement de Worldpay est plus grave car il concerne :
- Une anomalie structurelle et professionnelle : le défaut de vérification de l’agrément d’un partenaire (Seroph) censé opérer des services de paiement soumis à réglementation.
- Une connaissance indirecte des fraudes : Worldpay avait été informée par Seroph que des fonds transitaient vers des plateformes explicitement inscrites sur la liste noire de l’AMF, caractérisant une anomalie apparente.
Conclusion : une responsabilité accrue pour les intermédiaires techniques
L’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2025 représente un tournant dans la jurisprudence relative aux escroqueries financières en ligne. S’il confirme que la réglementation LCB-FT ne peut être invoquée directement par les victimes privées, il met en évidence que l’obligation générale de vigilance des professionnels (article 1240 du Code civil) est suffisamment large pour sanctionner les PSP qui ferment les yeux sur les anomalies manifestes.
Les professionnels, tels que Worldpay et Seroph, qui mettent à disposition les infrastructures de paiement, ne peuvent plus se contenter d’invoquer le principe de non-ingérence. Le fait d’utiliser la technologie et les comptes bancaires des PSP pour rendre possibles des placements manifestement frauduleux, y compris ceux figurant sur les listes noires des régulateurs, constitue une faute professionnelle engageant leur responsabilité conjointe.
Toutefois, cet arrêt maintient l’exigence de prudence des investisseurs : l’indemnisation est systématiquement réduite lorsque la victime n’a pas accompli les vérifications minimales (comme la consultation des listes AMF) qui auraient permis d’éviter le dommage. En matière d’investissements atypiques, la vigilance reste donc une responsabilité partagée, mais l’exigence de diligence envers les professionnels qui structurent le marché est indéniablement renforcée.