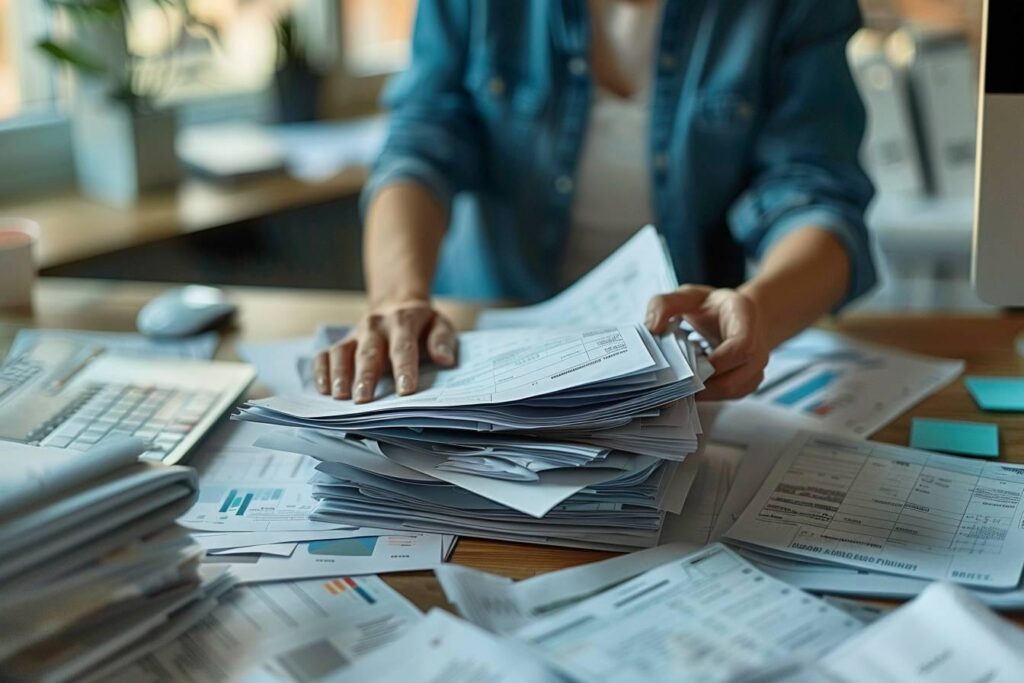Une décision importante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient d’être rendue, le 1er août 2025, dans l’affaire C-665/23 concernant Veracash. Cet arrêt clarifie des points cruciaux de la Directive 2007/64/CE, dite Directive sur les services de paiement dans le marché intérieur (DSP1), notamment en ce qui concerne le droit au remboursement des opérations de paiement non autorisées.
CJUE, 1er août 2025, C-665/23
Le Contexte : un litige entre un consommateur et Veracash sas
L’affaire opposait un consommateur à Veracash SAS, société auprès de laquelle il détenait un compte de dépôt en or. En mars 2017, Veracash a envoyé une nouvelle carte de retrait et de paiement au consommateur. Entre fin mars et mi-mai 2017, des retraits quotidiens ont été effectués sur ce compte. Le consommateur a soutenu n’avoir jamais reçu la carte ni autorisé ces retraits.
Le nœud du problème résidait dans le délai de signalement. Le consommateur a signalé les retraits le 23 mai 2017, soit près de deux mois après le premier retrait contesté. Les juridictions françaises de première instance et d’appel ont rejeté sa demande de remboursement, estimant que le signalement n’avait pas été fait « sans tarder » comme l’exige le Code monétaire et financier (qui transpose la DSP1), même s’il avait été effectué dans le délai maximal de treize mois prévu par la loi.
La Cour de cassation française, saisie du pourvoi du consommateur, a décidé de soumettre des questions préjudicielles à la CJUE pour clarifier l’interprétation de la directive. L’enjeu était de taille : un signalement tardif, même dans le délai de 13 mois, pouvait-il priver un consommateur de son droit au remboursement ? Et si oui, à quelles conditions et dans quelle mesure ?
La Décision de la CJUE : une double condition, mais des nuances cruciales
La CJUE, par son arrêt du 1er août 2025, a apporté des éclaircissements essentiels, structurés autour des trois questions posées :
1. L’obligation de signaler « sans tarder » et le délai de « treize mois » : deux conditions distinctes et cumulatives
La Cour a d’abord confirmé l’interprétation littérale de l’article 58 de la Directive 2007/64/CE. Pour obtenir la correction d’une opération non autorisée, l’utilisateur de services de paiement doit la signaler à son prestataire « sans tarder » ET « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ».
- Le délai « sans tarder » : Il s’agit d’une obligation subjective, déclenchée dès que l’utilisateur a connaissance de l’opération non autorisée. Elle implique d’agir dès que possible, compte tenu des circonstances. Cet objectif est préventif, visant à réduire les risques et les conséquences des opérations non autorisées.
- Le délai de « treize mois » : Il s’agit d’une obligation objective, qui court à compter de la date de débit de l’opération. C’est un délai maximal au-delà duquel toute action est forclose, garantissant la sécurité juridique pour les deux parties.
La CJUE souligne que considérer le seul respect du délai de treize mois comme suffisant porterait atteinte à la finalité préventive du signalement « sans tarder » et à l’équilibre des intérêts établi par la directive.
En substance, un utilisateur est en principe privé de son droit au remboursement s’il n’a pas signalé l’opération « sans tarder », même s’il l’a fait dans les treize mois.
2. La privation du droit au remboursement : seulement en cas d’intention ou de négligence grave
C’est là que la décision apporte une nuance fondamentale et protectrice pour le consommateur. La Cour a précisé que la privation du droit au remboursement n’est PAS automatique en cas de simple retard.
Lorsqu’une opération non autorisée résulte de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée d’un instrument de paiement (comme une carte bancaire), le payeur n’est privé de son droit d’obtenir le remboursement que s’il a tardé à signaler l’opération de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave.
- Négligence grave : La Cour la définit comme une violation caractérisée d’une obligation de diligence. L’évaluation doit tenir compte de toutes les circonstances, conformément au droit national.
- Agissement frauduleux : Si le payeur a agi frauduleusement, il supporte toutes les pertes. En dehors de la fraude, le payeur ne supporte aucune conséquence financière pour l’utilisation de l’instrument après la notification de perte/vol/détournement.
Cette interprétation est essentielle pour préserver l’effet utile de l’article 61, paragraphe 2, de la directive, qui limite la responsabilité du payeur aux cas de fraude ou de manquement intentionnel/négligence grave. Elle reflète la volonté du législateur de l’Union de favoriser une plus grande protection de l’utilisateur en cas de vol ou de perte d’un instrument de paiement.
3. Opérations successives : une responsabilité liée à la causalité
Concernant les opérations de paiement non autorisées successives résultant de la même perte, vol ou détournement de l’instrument, la Cour a statué que le payeur n’est privé de son droit au remboursement que des seules pertes qui résultent des opérations qu’il a intentionnellement ou de manière gravement négligente tardé à signaler.
Cette approche reconnaît un lien de causalité direct entre le comportement du payeur (retard intentionnel ou par négligence grave) et les pertes spécifiques qu’il ne pourra pas récupérer. L’évaluation du caractère tardif et de la négligence doit se faire pour chaque opération individuelle.
La Cour rappelle que l’article 61, paragraphe 2, qui établit la responsabilité du payeur, est une disposition dérogatoire au principe de responsabilité du prestataire (article 60, paragraphe 1) et doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte. Cela signifie que la charge de la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave du payeur repose sur le prestataire de services de paiement.
Implications pratiques pour les consommateurs :
- L’incitation à signaler rapidement toute opération non autorisée ou la perte/vol de l’instrument de paiement reste primordiale. C’est votre devoir d’informer « sans tarder ».
- Toutefois, cette décision vous offre une protection accrue. Un simple retard non intentionnel et non dû à une négligence grave ne suffira plus, en principe, à vous priver de votre droit au remboursement.
- Soyez conscients que si votre retard est intentionnel ou le résultat d’une négligence grave (par exemple, si vous avez manifestement ignoré des alertes flagrantes), vous pourriez perdre votre droit au remboursement, y compris pour l’intégralité des sommes si la fraude ou la négligence grave est établie.
- Les Banques plus refuser systématiquement le remboursement en invoquant un simple retard de signalement (même si celui-ci est au-delà du « sans tarder » mais dans les 13 mois).
- Pour se dégager de leur responsabilité, les Banques devront prouver l’agissement frauduleux du payeur ou sa négligence grave et intentionnelle dans le signalement.
- La charge de la preuve incombe à la Banque pour démontrer que l’opération a été authentifiée, enregistrée, et non affectée par une défaillance technique, mais aussi, le cas échéant, la faute intentionnelle ou la négligence grave du payeur.
- L’obligation des Banques de mettre à disposition des moyens appropriés pour la notification reste essentielle. En cas de manquement de la part de la Banque, le payeur n’est pas tenu de supporter les pertes (sauf fraude).
En Conclusion
Cet arrêt de la CJUE est un rappel clair de l’équilibre délicat que le législateur européen a voulu instaurer entre la responsabilité des utilisateurs et celle des prestataires de services de paiement. Il renforce la protection des consommateurs en exigeant que le prestataire prouve une faute caractérisée (intention ou négligence grave) de la part du payeur pour le priver de son droit au remboursement en cas de signalement tardif mais dans le délai des 13 mois. Il souligne également que, même en cas de faute, seules les pertes directement liées à cette faute peuvent être mises à la charge du payeur.
FAQ : Fraudes bancaires et vos droits au remboursement
Victime d’une opération de paiement non autorisée ? Votre carte bancaire a été perdue ou volée ? Comprenez vos droits grâce à la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui renforce la protection des consommateurs face aux fraudes bancaires.
Ai-je l’obligation de signaler « sans tarder » une opération non autorisée à ma banque ?
Oui, en principe, vous avez une double obligation de signalement :
- « Sans tarder » : Vous devez signaler l’opération dès que vous en avez connaissance. C’est une obligation « subjective », déclenchée par votre prise de conscience de l’opération non autorisée.
- « Au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit » : C’est un délai maximal « objectif » pour la sécurité juridique.
La CJUE a confirmé que le droit d’obtenir la correction d’une opération est, en principe, perdu si le signalement n’est pas fait « sans tarder », même s’il est effectué dans les treize mois. Le non-respect de l’obligation de signaler « sans tarder » peut compromettre l’objectif préventif de cette obligation.
Ma banque peut-elle refuser de me rembourser si mon signalement est jugé « tardif » ?
C’est là que la décision de la CJUE renforce significativement vos droits. Non, votre banque ne peut pas vous refuser le remboursement simplement parce que votre signalement a été « tardif », si ce retard n’était ni intentionnel ni le résultat d’une négligence grave de votre part.
Ce principe s’applique spécifiquement aux opérations de paiement non autorisées qui sont consécutives à la perte, au vol, au détournement ou à toute utilisation non autorisée de votre instrument de paiement.
Votre droit au remboursement ne peut être écarté que si:
- Vous avez agi frauduleusement.
- Votre retard à signaler l’opération était intentionnel.
- Votre retard était dû à une négligence grave, c’est-à-dire une « violation caractérisée d’une obligation de diligence » de votre part.
La Cour souligne que l’objectif de la directive est de favoriser une plus grande protection de l’utilisateur en cas de vol ou de perte d’un instrument de paiement. Un simple retard, s’il n’est pas intentionnel ou ne découle pas d’une négligence grave, ne peut donc plus justifier un refus de remboursement.
Qui doit prouver la « négligence grave » ou le « comportement frauduleux » ?
La charge de la preuve incombe à votre prestataire de services de paiement (votre banque). Si vous niez avoir autorisé une opération, c’est à la banque de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une défaillance technique.
L’utilisation de votre instrument de paiement, telle qu’enregistrée par la banque, n’est pas suffisante à elle seule pour prouver que vous avez autorisé l’opération, que vous avez agi frauduleusement, ou que vous avez manqué à vos obligations de manière intentionnelle ou par négligence grave. La banque doit apporter des preuves concrètes de votre faute caractérisée.
Que se passe-t-il s’il y a plusieurs opérations non autorisées successives ?
Si plusieurs opérations non autorisées se succèdent, toutes liées à la même perte, au même vol ou au même détournement de votre instrument de paiement, vous ne serez privé du remboursement que pour les pertes qui résultent DIRECTEMENT des opérations que vous avez intentionnellement ou par négligence grave tardé à signaler.
La Cour a insisté sur le fait que la responsabilité du payeur est une dérogation au principe général de responsabilité de la banque et doit être interprétée strictement. Cela signifie que la banque ne peut pas vous tenir responsable de toutes les pertes si votre faute (intentionnelle ou négligence grave) n’a concerné qu’une partie du signalement ou n’a pas causé toutes les pertes.
Que dois-je faire si je suis victime d’une opération non autorisée ?
- Signalez immédiatement la perte, le vol ou le détournement de votre instrument de paiement à votre banque ou à l’entité désignée. Votre banque a l’obligation de mettre à votre disposition des moyens appropriés pour le faire à tout moment.
- Signalez « sans tarder » toute opération non autorisée que vous constatez, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
- Si votre banque refuse le remboursement en invoquant un signalement tardif (mais dans les 13 mois), rappelez-lui la décision de la CJUE (affaire C-665/23, Veracash, 1er août 2025). Insistez sur le fait qu’elle doit prouver votre comportement frauduleux ou votre négligence grave intentionnelle pour justifier un refus.
- Sachez que, sauf agissement frauduleux de votre part, vous ne supportez aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après que vous l’avez notifié.
- Si votre banque ne vous a pas fourni les moyens appropriés pour signaler la perte ou le vol de votre instrument de paiement, vous n’êtes pas tenu de supporter les conséquences financières, sauf en cas de fraude de votre part.